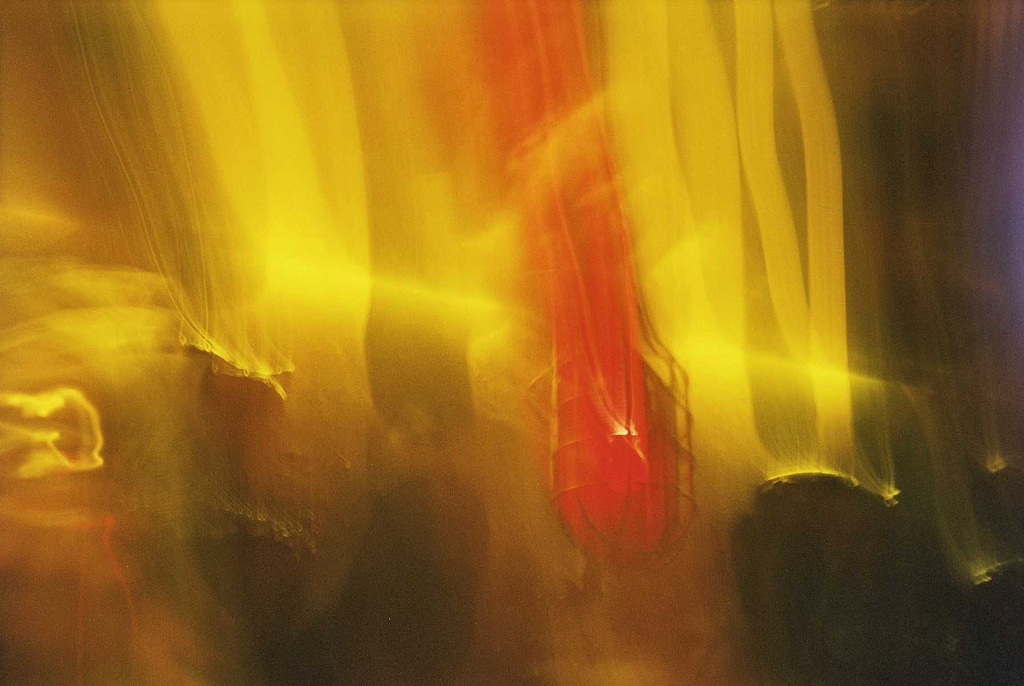Langues perdues, langues conquises

Les histoires de plurilinguisme m’émeuvent toujours beaucoup – les histoires de langues perdues me fascinent parce que je les trouve exotiques , et les histoires de langues conquises me plaisent parce qu’elles me sont familières. Mes parents étaient désespérément, terriblement monolingues, ils m’ont élevé à moins de 100 km de leurs lieux de naissance respectifs. Pas de bilinguisme pour moi – les autres langues que je parle, il a fallu les apprendre.
J’ai commencé l’allemand à 9 ans, en CM2, et l’anglais peu de temps après, sur le tas, seulement muni d’un vieux dictionnaire des années 60 et de l’envie de pouvoir jouer aux jeux de ma NES. Ensuite l’école a pris le relais. J’étais réceptif et motivé, j’ai appris vite.
Assez tôt, je me suis trouvé chargé communiquer avec les gens que nous rencontrions à l’étranger, en voyage. Meilleurs souvenirs : un premier de l’an à Prague, demander notre chemin à un chauffeur de taxi hongrois à Los Angeles, discuter avec un jeune Hopi venu de Flagstaff pour une cérémonie religieuse à Second Mesa, le type un peu agressif à Schwerin qui s’est trouvé désarçonné de m’entendre lui répondre en allemand.
A 16 ans j’en voulais beaucoup à mes parents de ne pas m’avoir fait bilingue, exotique et déraciné, parce que j’aurais trouvé ça romantique (l’ingratitude de l’adolescent incapable de voir la chance qu’il avait de voyager autant). J’étais déçu parce que je trouvais ça moins aristocratique de devoir apprendre d’autres langues que de les posséder. Je pouvais apprendre l’anglais et l’allemand mais ce ne seraient jamais mes langues, jamais vraiment en tout cas, jamais comme le français.
L’an dernier, un article de la romancière américaine Jhumpa Lahiri dans le New Yorker avait fait un peu de bruit. Elle raconte son apprentissage de l’Italien et comment elle est partie vivre à Rome, pratiquement sur un coup de tête.
La semaine dernière, j’y ai repensé en lisant un texte beaucoup plus court et, de mon point de vue, plus fort, sur les langues perdues et gagnées : dans On Language-Learning and the Decolonisation of the Mind, Iona Sharma raconte sa honte d’avoir perdu l’hindi et son apprentissage du gaélique.
J’ai pleuré à la fin.
A 25 ans j’étais obsédé par l’écriture, mais totalement enferré dans des expérimentations de forme hermétiques et vaines (si vous lisiez dejà nologos.net à l’époque : pardon). C’était les débuts de McSweeney’s Internet Tendency, je lisais HTML Giant tous les jours, j’étais au fait de la carrière de Tao Lin, et au bout d’un moment je me suis dit qu’il fallait peut-être faire l’effort d’écrire en anglais pour sortir de l’impasse.
J’ai encore quelque part un texte presque fini et assez drôle que j’espérais envoyer à McSweeney’s. C’était le monologue d’un type invectivant une famille américaine stéréotypique dans le métro de Paris. Ca jouait à la fois sur les clichés des touristes et des Parisiens, et le twist, car il en fallait bien un, est que c’était écrit avec un lourd accent français (w -> v , th -> z, h -> ‘)
Il m’avait fallu des semaines pour pondre quelques pages, mais évidemment j’ai laissé tomber avant d’avoir tout à fait fini et de me trouver soudain acculé à les envoyer – parce qu’en vérité, mon problème d’écriture n’était pas un problème de langue.
Demain je retourne à Berlin rendre visite à mon ami Frédéric (il a sorti un nouveau petit livre, j’en reparle bientôt) – qui a des choses à dire sur le bilinguisme, lui aussi. Son père est français et sa mère allemande, il parle un français impeccable, mais pour l’instant il ne se sent pas d’écrire en français.
A Berlin je vais aussi visiter une école primaire pour mes enfants, où ils pourraient apprendre l’allemand sans perdre leur français. Je ne sais pas encore si on partira, mais je suis heureux d’avoir enfin compris que le bilinguisme que j’ai tant désiré attendait seulement que j’aille le trouver.
Photo : Dirk Dittmar
Le pic de Paris

La manifestation partait à 14h de Denfert, mon train arrivait à Montparnasse à 14h55. Je suis resté loin mais j’ai vu tout de suite que les copains n’exagéraient pas : des flics partout et tendus, des bruits sourds et non identifiés se succédant rapidement, des hélicos très bas. L’ambiance c’était plutôt Predator 2 que le Péril jeune. J’ai prudemment replié mon vélo et j’ai pris le métro, sous le regard indifférent des gens aux terrasses des cafés. Le désastre à l’horizon, et autour de ça : Paris, superbement égal à lui-même, aussi blasé et désinvolte qu’à l’accoutumée.
Quand je suis sorti du métro à Opéra, il s’est mis à pleuvoir des trombes d’eau. Un déluge. Je me suis réfugié sous le porche d’un grand immeuble, en compagnie d’une vieille dame, de trois peintres, de trois ou quatre jeunes professionnels des deux sexes en grande conversation sur les restos du quartier, de deux touristes asiatiques, et d’une jeune femme absorbée par son téléphone et sa cigarette. J’avais envie de les remercier, voire de les prendre en photo tant la scène était délicieusement familière – parisienne. Je n’ai pas osé, mais je crois que c’est le moment où j’ai pris la résolution de passer un week-end de touriste.
La canopée des Halles je l’ai trouvée très belle, et j’ai été surpris de constater à quel point ma perception du lieu était bouleversée par le fait de pouvoir le traverser, alors qu’avant on ne pouvait que le contourner ou s’y engouffrer. Paradoxalement c’est un peu décevant de découvrir les Halles si petites, maintenant qu’on ne s’y heurte plus. De mes premières visites à Paris, enfant, j’avais toujours gardé le souvenir d’une incommensurable fourmilière cyberpunk dont les escalators puants avalaient des hordes de gens sans discontinuer, la surface restant un espace vide, un peu inquiétant et compartimenté, bilalien. Plus rien d’inquiétant, désormais : je suis allé dans la boutique Lego et j’ai rempli une boîte comme on achète des bonbons, avec une joie toute enfantine.
Ensuite j’ai pris les escalators et bizarrement c’est en arrivant tout en bas, à l’endroit où l’orientation devient entièrement agéographique, que j’ai le mieux retrouvé mes marques : le forum des images, la piscine, le Cité Ciné. Toujours le même dallage et les mêmes piliers. Je serais incapable de dessiner un plan mais je sais quel couloir suivre pour arriver à tel ou tel bout.
(Bon j’ai quand même essayé d’aller à l’UGC Orient-Express alors qu’il a fermé il y a plus de deux ans.)
Les piscines, d’ailleurs : l’expérience aura été très homogène, et nettement meilleure que dans mon souvenir. Peut-être que je me suis seulement habitué aux vestiaires, entre temps. Peu importe. Aux Halles j’ai tenu 500m dans la ligne d’eau des bourrins (pardon, des « nageurs confirmés ») avant de devoir aller faire de la brasse molle pour me remettre, alors que le lendemain à Pailleron j’ai laissé tout le monde sur place. Difficile de savoir pourquoi : bassin de 50m contre 33, pas le même public en semaine et le week-end, ou plus vraisemblablement la différence entre trois ou huit heures de sommeil la nuit précédente.
J’ai visité consciencieusement tous les quartiers où j’ai vécu, pour faire semblant de ne jamais être parti. En trois jours j’ai quadrillé à vélo une grande partie du quart nord-est de la ville, avec l’envie de m’arrêter pour prendre des photos toutes les cinq minutes.
A Belleville j’ai vu un Chinois juché à l’arrière d’un camion qui déchargeait à l’épuisette une cargaison de poissons frétillants, un feu tricolore de guingois mais toujours fonctionnel, et un photographe se ruant au milieu du boulevard entre deux bagnoles pour saisir une mariée traversant la rue dans sa robe à traîne.
Aux Buttes Chaumont j’ai croisé un type que faisait son footing dans un t-shirt de la CNT, des adolescents en kippa qui se battaient violemment puis rigolaient puis recommençaient à se battre, et une assez jeune fille au téléphone qui expliquait à son correspondant, mais surtout à la cantonade, que Machin était exactement le vingtième mec avec qui elle avait couché, c’est dingue non ?, et qu’elle voyait Truc ce soir. Elle espérait susciter des regards choqués ou incrédules (peu importe, des regards), mais je crois être le seul à m’être retourné. Décidément je suis redevenu un plouc.
Dans le Marais j’ai constaté que la brooklynification galopante gagnait des rues que je croyais immuables. Dans les grands magasins je me suis soumis de bonne grâce aux contrôles de sécurité absurdes. Dans le métro, j’ai vu trois jeunes filles discuter de séries, en beuglant notamment qu’il fallait ab-so-lu-ment regarder tout Grey’s Anatomy depuis le début, avant d’entreprendre de spoiler l’intégralité des épisodes récents du Trône de Fer. Je craignais beaucoup pour leur sécurité. J’ai vu des galeries vendant du street art, et un type en train de démonter une vieille moto anglaise dans une boutique absolument blanche et vide, et partout des hordes de livreurs de bouffe en fixie.
J’ai vu de vieux amis épuisés et hagards, usés par le boulot, les enfants, l’ambiance, les lacrymos, la peur – usés par Paris.
Figure nécessairement parmi les finalistes du championnat du truc le plus XIe de tout le XIe cette pharmacie pourvue d’une jardinière où poussent des plantes aromatiques en libre service, rue Popincourt je crois.
Passage de la Main d’or, j’ai bu très tard dans un bar très sale au personnel complètement saoul, où deux filles inconnues ont tenté de nous contraindre physiquement, mon acolyte et moi, à danser sur une chanson d’Etienne Daho. Nous avons dû objecter que nous étions d’honnêtes pères de famille pour nous dérober. Ailleurs j’ai bu des pintes de bière artisanale délicieuse et ridiculement chère, mangé des salades thaï exquises et des falafel et des planches de fromage, visité des librairies (plusieurs d’affilée !) et des concept stores pour enfant – toutes choses que j’ai dû apprendre à ne plus tenir pour acquises, ces dernières années.
Rue des Boulets j’ai constaté que Le Franprix avait fait peau neuve – il a désormais d’immenses vitrines au lieu des façades aveugles et dégueulasses que je lui ai connues pendant des années. Et le Dia de Pyrénées est devenu un Carrefour Bio, et mon kebab préféré de la rue Jean-Pierre Timbaud une pizzeria prétentieuse.
Rue Chanzy j’imaginais trouver le Titon désert, avec tous les gens du cinémâ partis à Cannes, mais pas du tout : les auteurs et éditeurs assuraient l’intérim avec beaucoup d’application. C’était à celui qui gueulerait le moins subtilement « … parce qu’ils ont JOUÉ MA PIÈCE… en juillet EN ARGENTINE pour une RÉSIDENCE D’ARTISTE… m’avait prêté leur appartement à LISBONNE, c’était trop bien j’ai pu ÉCRIRE pendant une semaine… » Etc. J’ai noyé mon agacement et ma jalousie dans la bière.
Je suis arrivé en retard à peu près partout. J’ai perdu l’habitude de l’organisation des soirées, parce qu’il est devenu si rare que j’ai plus d’amis à voir que de temps pour le faire. Finalement j’ai aussi eu du mal à échanger ne serait-ce que quelques phrases avec chacun, ça aussi c’est une gymnastique dont j’ai perdu l’habitude.
Mais rien de tout cela n’est le pic de Paris. Le trophée appartient à une histoire qu’on m’a racontée. C’était la semaine dernière, je crois. Avenue Simon Bolivar, un peu avant d’arriver aux Buttes Chaumont, un gros scooter double une voiture à vive allure. Manque de chance, en face, un bus. Choc frontal. Le motard désarticulé mais encore vivant est évacué vers le trottoir par des passants, au milieu de la circulation interrompue. La vitre de la voiture que le scooter avait tenté de doubler se baisse alors, et le conducteur entreprend de pourrir l’accidenté, maudissant les scooters, leur imprudence et leur bêtise. Les passants lui font remarquer que ce n’est peut-être pas le moment, l’automobiliste s’en moque et continue de vociférer jusqu’à l’arrivée des secours.
L’éducation

Un mot d’abord :
J’ai été élevé par des parents féministes. Au quotidien ça se traduisait notamment par le fait que ma mère était la personne la plus occupée du foyer, celle dont il fallait s’accommoder, celle qui avait le rôle héroïque. Mon père faisait les courses, le diner, s’occupait de moi, tandis que nous attendions interminablement qu’elle rentre de l’une de ses innombrables réunions. Quand j’ai grandi, j’ai eu droit au récit des faits d’armes, le MLF, les manifs, les cars pour avorter en Angleterre, la totale – et puis les récits exemplaires sur le sexisme au quotidien, les stéréotypes, la misogynie d’autant plus pernicieuse chez les gens de gauche qu’ils se croient du côté du Bien.
Aujourd’hui, il est de bon ton de se moquer des féministes militantes (et je concède qu’elles sont souvent agaçantes ou désagréables à lire), mais c’est bien grâce à leurs vérités déplaisantes que j’ai pu constater que la meilleure volonté de mes parents n’était pas parvenue à m’immuniser magiquement contre le sexisme, comme je l’ai longtemps cru.
– et voilà qui constitue une préambule adéquat à un texte sur ma tentative pour donner à mes enfants une éducation féministe.
(suite…)
Maigrir

Il en va de l’obésité comme du tabagisme : on est trop souvent confronté à des discours moralisants ou irrationnels, qui n’informent personne. C’est idiot parce que la stigmatisation ni la pensée magique n’ont jamais aidé qui que ce soit. En deux ans j’ai perdu une vingtaine de kilos que je n’ai pas repris depuis, je vais essayer de résumer ce que ça m’a appris, en essayant d’être le plus honnête possible.
J’étais gros, je ne le suis plus, mais j’en ai gardé des difficultés (un inconfort) dans les rapports humains. Quand on est gros, on sent sur soi en permanence (ou on imagine, peu importe) les regards méprisants, à la caisse du supermarché, au restau, quand on marche dans la rue, quand on fait du vélo, etc. – et vous savez pourquoi on le sent ? Parce que c’est le regard qu’on porte sur soi-même. On sait bien qu’on n’est pas très séduisant, on sait que ça va être une bataille pour être pris au sérieux chaque fois qu’on rencontre quelqu’un. Les gros sont ridicules. Ils ne savent pas se maîtriser. Pff.
Une fois qu’on est gros, redevenir mince est extrêmement difficile. Ca nécessite de s’affamer pendant des mois. Il ne suffit pas de manger bien – ça c’est pour rester mince – il faut manger trop peu, et ce alors même que la nourriture est un des rares réconforts fiables qu’on connaisse encore.
Les cinq ou dix premiers kilos partent assez vite, en quelques semaines. C’est la bonne nouvelle. On se prive des choses qui contribuent le plus manifestement à entretenir le gras, on arrête de se goinfrer et on a un minimum d’activité physique – une demi-heure par jour, de marche ou de vélo ou quoi, jusqu’à sentir qu’on va transpirer – c’est important de ne pas s’épuiser, parce que ça donne faim. Bref. C’est très douloureux, la faim fait tourner la tête, les efforts de volonté à accomplir sont violents, mais heureusement les résultats sont rapides – c’est d’ailleurs le seul moment où ça m’a aidé de me peser régulièrement.
Cette première étape montre que ce qu’on croyait impossible ne l’est pas, mais qu’il va vite falloir trouver une autre stratégie. On ne peut pas continuer éternellement à se priver de dessert, de crème et d’alcool, et à se gaver de carottes et de concombres pour se sentir le ventre plein. Les vrais difficultés commencent.
L’objectif c’est de trouver un mode de vie tenable à long terme, qui rend plus heureux qu’on ne l’était. Apprendre à aimer les crudités et le dal comme on aime le saucisson et le fromage – sans remplacer nécessairement les uns par les autres. C’est difficile quand on a passé sa vie à se trouver des excuses pour s’empiffrer, et on n’est guère aidé par le chemin qui reste à accomplir.
Beaucoup de gens qui ont maigri en gardent un rapport conflictuel à l’alimentation. Essayez de peser tout ce que vous ingérez dans une journée, puis de calculer l’apport calorique que ça représente, puis de vous assurer que cet apport calorique est insuffisant, et recommencez chaque jour pendant un an ou deux, vous verrez que ça laissera des traces. Paradoxalement ça crée un sens de la camaraderie chez les anciens obèses qui n’est pas sans évoquer (toutes proportions gardées, hein) un bizutage ou un camp d’entraînement de l’armée. On se reconnaît, on sait ce qu’on a vécu. Mais ça n’aide guère à créer un rapport sain à la nourriture. Les médias font tout un flan autour des forums pro-ana, mais très franchement allez faire un tour sur des forums de musculation au poids du corps ou quoi, quand les gars racontent leurs stratégies de sèche on est clairement dans le pathologique.
Le fond du problème, je crois, c’est que contrairement au tabagisme, il est difficile d’arrêter de manger. Et il est nettement plus facile d’apprendre la privation que la modération.
Je n’ai pas vraiment de solutions à offrir pour y parvenir, à part l’acharnement et la discipline. Je ne sais pas s’il faut en passer par l’étape décompte des calories ou si on peut directement s’habituer à manger des portions raisonnables – mais comment sait-on qu’elles sont « raisonnables », dans ce cas ? Est-ce qu’on doit devenir végétarien ? On peut tout à fait. Déjà manger peu de viande ça aide beaucoup, tant à maigrir qu’à se sentir mieux et à avoir une autre vision de ce qu’on mange. Quand est-ce qu’il faut s’arrêter de mincir ? C’est difficile aussi. On peine à se voir tel qu’on est. Est-ce qu’il faut faire du sport ? Ca aide à se sentir plus en forme, pas nécessairement à mincir.
Tout ce que je peux donner c’est une perspective : après, on se sent mieux.
Photo : Dan Goodwin
Maintenant

Après une vie à tergiverser et quatre ans à prendre de l’élan, ça y est : j’ai tout plaqué pour devenir imprimeur lo-fi en bord de mer.
La vraie question c’est de savoir ce qui m’a retenu si longtemps. J’ai toujours eu les moyens de faire ce que je voulais, tant matériels qu’intellectuels, parce que mes rêves les plus fous sont très simples et un peu pâles : je veux avoir une photocopieuse, raconter des histoires, et n’ôter mon chapeau devant personne.
Le principal obstacle que j’ai dû surmonter aura donc été ma propension à me saborder systématiquement à quelques mètres de la ligne d’arrivée.
A 16 ans j’avais ma vocation mais je n’ai rien fait parce que je refusais de me contenter de produire quelque chose de médiocre. Je voulais savoir plus avant de me lancer, pour être sûr de me consacrer à une entreprise valable, objectivement digne d’être poursuivie, et parce que je voulais réussir du premier coup.
En somme j’espérais une révélation. Pour la faire venir, j’ai étudié l’histoire, appris des langues, lu des philosophes et des poètes, espérant chaque fois me trouver un maître. Pour passer le temps j’ai joué au go, aux échecs, au mah-jong. J’ai appris à traduire, à écrire, à programmer – tout ça passablement mais guère plus, puisqu’il ne s’agissait que de passer le temps en attendant l’épiphanie qui ne pouvait manquer de se produire – d’un instant à l’autre, désormais.
En étant parfaitement honnête : à 16 ans je n’ai rien fait parce que le seul débouché que je pouvais imaginer à ma production, dans le fond ma province, me faisait gerber. La perspective d’être applaudi par 200 personnes, dans le meilleur des cas, et certainement des amis de mes parents en majorité, était insupportable. La ville était trop petite pour mon ego, et réussir dans ses limites eut été un premier aveu de médiocrité.
Je trouvais tout à chier. Les jeunes artistes : nuls, hermétiques, enfermés dans des circuits merdiques et clos, à réclamer des subventions pour produire des œuvres fonctionnant essentiellement comme supports d’un discours, le tout (œuvre + discours) calibré pour les amis de leurs parents.
Je n’aimais pas les graphistes, non plus, et les designers encore moins. Soit complexés par l’absence de légitimité universitaire de leur discipline, soit, plus agaçant encore, absolument sans complexe et produisant à la chaîne des discours mal maîtrisés et creux.
Les gauchistes ? Peuh ! Ridicules, eux aussi. Des enculeurs de mouches, des pissefroids inefficaces, tous autant qu’ils étaient.
Les journalistes ? Des laquais incultes.
Les universitaires ? Des carriéristes myopes.
Les gens ? Bah. Qu’ils crèvent.
Voilà à peu près comment je me suis retrouvé là. Passé partout, resté nulle part, préférant toujours abandonner en cours de route qu’aller au bout et me trouver soudain face à mes compromissions ou, pire, à un résultat pas à la hauteur de mes espérances. Toujours en quête du prochain projet, de la prochaine idée, de la révélation. Jusqu’à ce que je finisse par comprendre qu’elle ne viendrait jamais parce qu’il n’y avait rien. Pas de maître, pas de grand mystère, rien qui mérite objectivement que je m’y consacre.
Malheureusement, personne n’allait pouvoir choisir pour moi.
Quand mes parents sont morts, j’ai finalement fait assez peu d’achats inconsidérés avec leur héritage : un lecteur MiniDisc collector, une veste de vélo épouvantablement chère, quelques boîtes de Lego. Quand je vous dis que je manque cruellement de fantaisie.
— Ah oui, si, quand même : j’ai acheté un atelier de sérigraphie sur le bon coin.
La sérigraphie ça m’a toujours fasciné. Je pense que c’est l’encre.
— ça et le fait que j’ai passé mon enfance trimballé par ma mère entre la Fanzinothèque du Confort Moderne et Scoop en Stock, un festival de presse alternative qui se tenait dans ma ville – imaginez un gamin rondouillard en polo Lacoste lâché entre les punks et les photocopieurs, au beau milieu de dizaines de stands où tout le monde est bourré à la bière blonde de luxe et met tout ce qui lui reste de lucidité à imprimer des journaux méchants et des affiches obscènes, tout en écoutant Pigalle et les Thugs à fond les ballons, ça vous donnera une idée. Je peux me raconter beaucoup d’histoires mais la vérité c’est que je n’ai jamais rien voulu d’autre que de pouvoir un jour en faire autant.
Dix ans après, avec les copains, on avait fait Kactus. C’était bien. Nos bouclages étaient des bacchanales, nos articles dénonçaient grave, notre humour était violent et sale. C’était bien.
Aujourd’hui je peux regretter les blagues misogynes et la myopie dont j’ai souvent fait preuve, je peux trouver cent raisons au fait que ça se soit délité au bout de cinq ans, je peux chercher où j’ai merdé, mais c’est idiot : c’était bien, et je n’ai rien fait d’aussi bien depuis.
Bref. Dix ans plus tard encore, je me suis trouvé avec 10 m3 de matériel de sérigraphie sur les bras et pas d’endroit où l’installer. C’était l’été 2012.
Sur ces entrefaites, j’ai eu deux enfants, j’ai entamé une thèse, j’ai vidé des maisons, j’ai parlé à des colloques et publié des articles, j’ai quitté Paris, j’ai écrit un logiciel, j’ai traduit des monceaux d’inanités, j’ai laissé tombé ma thèse, j’ai imaginé des escaliers absurdes que j’ai fait construire, j’ai entrepris d’écrire un feuilleton interminable sur le Japon et les îles – et pendant tout ce temps je traînais derrière moi ma table de sérigraphie (3,5 m2, 180 kg), les dents serrées, absolument pas décidé à la lâcher.
En juin 2015, j’ai fini par trouver un atelier, après avoir enfin réussi à me dépêtrer de tous les plans foireux dans lesquels je m’étais fourré, de peur que la voie ne soit libre et qu’il ne me reste plus qu’à faire.

Ensuite j’ai passé l’été à fabriquer une insoleuse et à apprivoiser mes machines, l’automne à acheter des encres et du papier sitôt que j’avais gagné quelques sous, l’hiver à dessiner des modèles, et ces dernières semaines à faire des photos et du webdesign.
Aujourd’hui, c’est l’aboutissement du processus entamé il y a bientôt quatre ans. Je ne vous cache pas que je suis terrifié. J’ai l’impression de monter sur scène pour la première fois de ma vie, dans une petite salle de province à moitié vide. Je regarde les gens à la dérobée, depuis les coulisses. Ils ne paraissent pas franchement hostiles, simplement ils ont autre chose à penser – ça ne va pas être facile de les intéresser, contrairement à ce que je croyais à 16 ans.
Allez, c’est l’heure. Quelques pas bien assurés et j’attrappe le micro.
« Bonsoir ! Nous sommes Cœur de Toner. »
Les guitares lancent des riffs énormes.
Paris, 2016

Rue de Lancry. Je sors d’un déjeuner dans un des multiples restos néoclassiques du coin. La souris d’agneau était exquise, la fille de mes amis a eu de l’écrasé de pommes de terre et des petits pois (« Non monsieur, nous n’avons pas de frites. »).
Au coin de la rue Yves Toudic, un graffeur manifestement autorisé est perché en haut d’un escabeau. Il est très appliqué, c’est du sérieux. Il a fini l’esquisse – je découvre à cette occasion que la bombe bleu ciel, c’est le fusain du graffeur – et s’apprête à entamer la fresque elle-même.
L’artiste s’arrête un instant pour consulter son modèle avant de donner le premier coup de bombe. Avec lui, il y a une nana qui le regarde / l’encourage (je ne peux pas m’empêcher d’imaginer que c’est sa productrice ou quelque chose comme ça), ainsi qu’un type en bonnet qui essaie désespérément d’avoir l’air cool et passe son temps à bidouiller une GoPro (je décide que c’est l’assistant). Les deux subalternes sourient. On fait vraiment des métiers formidable, quelle chance de pouvoir assister en direct à l’acte de création, que de frissons, que de beauté.
Au pied du mur en train d’être peint, un matelas et une masse informe d’édredons sous laquelle je finis par comprendre qu’un type dort.
Photo : Lauren Rauk
La cohabitation

Je reviens de quelques jours à Berlin (dans un appartement Ikea-vieux plancher-AeroPress de Prenzlauer Berg, naturellement). Au quotidien, le plus dépaysant aura sans doute été la cohabitation pacifique – sereine, même – entre cyclistes, piétons, voitures et trams.
Pour qui a vécu dans une grande ville française, c’était à n’y rien comprendre : les pistes cyclables berlinoises se limitent généralement à un changement de texture ou de couleur du trottoir, les vélos sont nombreux, et pourtant je ne sais pas si j’ai seulement entendu un klaxon ou un coup de sonnette. La cohabitation se fait sans friction ni animosité, les vélos ralentissent quand la densité de piétons augmente et accélèrent quand la voie est libre.

L’étendue de Berlin (50km du nord au sud, 60km d’est en ouest, à la louche) ne pose guère de problèmes : le S-Bahn, en gros équivalent au RER, va vite et passe relativement fréquemment. Les lignes circulaires qui entourent le centre de Berlin facilitent grandement la circulation, par rapport au modèle ultra-centralisé de la RATP. Les stations de S-Bahn sont pratiquement toutes équipées d’ascenseurs, et les trains sont donc accessibles aux personnes en fauteuil roulant, aux vieux, aux poussettes, aux vélos. Dans les voitures, des aménagements incroyablement ingénieux et complexes (des strapontins) permettent de caser tout le monde, même en cas d’affluence – chez moi, pendant ce temps, les TER de la SNCF s’étouffent dès qu’il y a plus de quelques cyclistes par wagon.
L’attitude des automobilistes est assez différente, aussi. Par exemple les voitures s’arrêtent pour laisser passer les piétons, ce qui m’a d’abord causé une certaine perplexité. J’avais l’impression de gêner – en France, on intériorise l’idée que la voiture est toujours prioritaire sur le piéton. Là une Porsche gigantesque a pilé au milieu de la rue parce que j’avais seulement jeté un oeil sur le trottoir d’en face, avant de repartir sans manifester le moindre agacement. Le soir, sur les grandes artères, la vitesse des voitures est limitée à 30 km/h pour que les riverains puissent dormir en paix, et les automobilistes respectent la mesure.
Le résultat c’est qu’il y a des vélos partout à Berlin, dans les rues et dans les trains, garés le long des immeubles et accrochés dans les rues au moindre point fixe, y compris des vélos pour enfants, eux aussi pourvus de paniers et de porte-bagages, de gardes-boue, des sacoches, des guidons rafistolés, bref la preuve qu’ils sont tous manifestement des véhicules et non pas seulement des engins de loisir.

Vous imaginez laisser un enfant faire du vélo à Paris, même en l’accompagnant ? Evidemment les deux villes sont très différentes : Berlin est extrêmement peu dense par rapport à Paris, et ses rues sont beaucoup plus larges. Mais même dans les quartiers neufs comme Paris Rive Gauche où, vu l’ampleur des travaux, tout aurait été possible, les trottoirs créés sont étroits, et l’espace non construit est presque exclusivement dévolu aux bagnoles. Les équipements cyclables sont peu fiables (au sens où on n’est jamais certain de l’endroit où ils vont tout bonnement cesser d’exister) et souvent occupés par des livreurs ou des gens pressés.
Et le problème ne se pose pas qu’à Paris. J’habite dans une station balnéaire minuscule et essentiellement peuplée de retraités, où la bagnole est reine. Mon fils a réclamé de pouvoir aller à l’école à vélo dès qu’il a su en faire sans roulettes. J’ai fini par vaincre ma terreur et céder prudemment à ses supplications : le jour de la Toussaint, nous avons quitté la maison vers 10h du matin pour parcourir le petit kilomètre qui nous sépare de son école. Comme ça, pour faire un test, sans stress. Le trajet se passe sans encombres, mon fils respecte les panneaux, grimpe la côte, s’arrête au stop. Je suis fier comme un paon. Au moment de redémarrer, il en chie un peu pour faire son démarrage en côte. Et là, un automobiliste arrive derrière nous et klaxonne, jusqu’à ce que je doive descendre de vélo pour aide mon gamin paniqué à se pousser. Autant vous dire que ça a guéri mon fils de son envie de se déplacer à vélo pour un petit moment.

Fidèles à leur légende, les vélos berlinois sont pourris et très simples, avec seulement des équipements basiques comme des sacoches ou des paniers. On est aux antipodes des supers vélos utilitaires à la mode ces dernières années, ce qui n’empêche pas les Berlinois de s’en servir en masse. Donc les bakfiets et les vélos cargo, c’est très bien, super cool, mais certainement pas nécessaire. En France, la plupart des gens ont déjà des vélos avec lesquels ils pourraient parfaitement faire leurs courses, transporter leurs enfants et aller bosser, si seulement ils se sentaient en sécurité pour le faire.
Il n’y a pas de fatalité à ce que ce soit toujours comme ça. Il suffit de comparer les photos d’Amsterdam dans les années 70 à la situation actuelle pour s’en convaincre : on peut faire des choix politiques qui changent durablement les villes et les mentalités.
Malheureusement, ce n’est pas le chemin qu’on prend. Le plan vélo de Paris est admirable, mais il manque encore cruellement d’ambition et de financements. En l’état actuel, il parvient à convaincre les piétons et les usagers des transports en commmun de faire du vélo, mais pas les automobilistes. D’une manière générale, les cyclistes continuent d’être vus comme des illuminés qui empêchent les voitures de rouler à pleine vitesse et sont responsables des accidents qui les frappent. Après les débats sur le gilet jaune et le casque audio de ces derniers mois, le spectre du casque obligatoire est de retour. Or l’effet principal d’obliger les gens à porter un casque est de les conduire à faire moins de vélo, en particulier les enfants.

Les actions individuelles ne suffiront pas, et elles ont même un effet repoussoir. Je n’ai pas de voiture, mais j’évite d’en parler – autour de moi, les gens ont l’impression qu’il s’agit d’un choix militant qu’ils n’ont pas le courage ou la possibilité de faire, alors ils culpabilisent ou se replient sur des moqueries. Et en vérité ils n’ont pas tort : tant que ce sera un sacerdoce de se déplacer à vélo, la pratique restera marginale.
Le problème c’est qu’il ne devrait pas être question d’héroïsme, mais d’infrastructures. Si on ouvre des lignes de chemin de fer au lieu de rafistoler des routes perpétuellement encombrées, si on pense l’urbanisme pour d’autres usagers que les automobilistes au lieu de les considérer comme des nuisances, eh bien bizarrement les autres usagers se matérialisent comme par enchantement.
Photos : Alexander Rentsch
Partir
Sur les photos, l’expérience authentique du vrai Berlin des vrais Berlinois ressemble à s’y méprendre au vrai Brooklyn, au vrai Paris, au vrai Varsovie, au vrai Séoul. Des meubles Ikea et des bibelots un peu crasseux, des murs blancs, du parquet, beaucoup de choses colorées qui pendent.

Toujours le même appartement, partout, qui appartient en réalité à une sorte de résidence distribuée et invisible dont les couloirs sont des vols EasyJet. Elle abrite les membres d’une diaspora cosmopolite qui vivent dans des unités pratiquement indistinguables, toujours situées dans des enclaves cool et honnies, comme si la classe créative entretenait des concessions jumelles dans toutes les capitales du monde.
Tous les habitants de cet immeuble mondial sont amis. Ils s’accueillent volontiers les uns les autres. Grâce à un ingénieux système de réservation en ligne, on s’invite chez ses voisins sur un coup de tête – les frontières on s’en fout, c’est pas pour nous –, pour se changer un peu les idées et pour aller voir si l’herbe est plus verte de l’autre côté du pallier, si on pourrait être heureux là-bas, si la bière est bonne et s’il y a des écoles bilingues pour nos enfants. On loue sur AirBnB un appartement qui ressemble singulièrement au nôtre, comme s’il s’agissait d’un premier contact en vue d’un échange de vie. Si ça nous plaît, on pensera à déménager.

Le système d’évaluation d’AirBnB a quelque chose de tout à fait glaçant en ceci qu’il ne prétend pas noter le logement loué, ni même la qualité du service rendu, mais bien la personne qui le rend, « l’hôte ». Les commentaires positifs ne parlent pas d’un superbe appartement très bien situé, mais d’un excellent hôte, très accueillant, serviable, etc.
Ca conduit à une escalade du zèle chez les hôtes qui, tels des chauffeurs Uber, sont terrifiés à l’idée qu’on leur laisse une évaluation dégueulasse (« La boîte de mouchoirs de la cuisine était pratiquement vide à notre arrivée, et on ne capte pas le WiFi depuis les toilettes du fond. Je pense que Flora et Ben devraient faire un petit effort pour améliorer leur hospitalité ! »). Du coup ils rivalisent de politesses et de petits services absurdes pour s’assurer d’une évaluation positive, tels, encore une fois, des chauffeurs Uber avec quatorze sortes de bonbons dans leur boîte à gant et qui prient les passagers choisir la musique.

AirBnB tend donc à ressembler plutôt à un réseau social où de jeunes professionnels s’entrecongratulent sur la qualité de leur déco qu’à un site de locations de vacances. Il s’agit d’entretenir l’illusion que tout cela n’est qu’un arrangement entre personnes de bonne compagnie, que le service rendu l’est avant tout à titre amical.
Vu les tarifs pratiqués et la réalité de la situation – (a) des gens qui essaient tant bien que mal de payer les loyers exhorbitants des métropoles en sous-louant leur logement ou (b) des gens qui font un maximum de fric en transformant en hôtels clandestins des logements rénovés à la va-vite –, cette avalanche de politesses et de marques de connivence a quelque chose d’un peu loufoque. Mais peut-être qu’il y a quelque chose de vrai là-dedans, au fond. Peut-être reconnaissons-nous instinctivement qu’il se joue quelque chose de l’ordre de la cooptation quand nous choisissons nos photos de profil et que nous écrivons nos bio pour AirBnB. On est entre gens de bonne compagnie, ici. On parle tous trois langues, on a voyagé. Nous aussi on a un appartement stylé et un peu biscornu, avec des sérigraphies au mur et des tonnes d’épices ramenées de nos voyages.

Peut-être qu’on trouvera ça super et qu’on décidera de déménager. On décollera nos polaroïds du mur pour aller les recoller ailleurs. Il faudra trouver un sacré boulot de connard pour payer tout ça, le loyer et les déménagements et l’école française et les retours au pays pour les fêtes et tout, mais ça ne devrait pas être trop compliqué, node et Angular n’ont pas de patrie, eux non plus. Les nouveaux collègues nous traiteront avec une familiarité tout à fait glaçante, eux aussi. Nous serons immédiatement leur ami, des gens comme eux qui ont réussi à s’extraire de leur triste terroir pour venir grossir les rangs des créatifs. Il faudra être passionné par le job, la boîte, l’avenir, les nouvelles tendances du webdesign ou que sais-je. Il faudra être enthousiaste, amical, incolore. Ce sera facile. Il suffira de mettre en oeuvre les leçons apprises en louant nos logements à des graphistes tâtillons et des jeunes couples exigeants.
Une fois installés, nous reprendrons vite nos marques. Une librairie, un bar sympa, un endroit qui sert du café décent, un appartement avec du vieux parquet et des choses colorées qui pendouillent, et une nounou trilingue qui, dans dix ans, prendra notre place.
Ailleurs
En Russie, les jeunes intellos moscovites désemparés de voir leur pays sombrer dans un autoritarisme grotesque ne luttent pas contre Poutine (trop dangereux), et ils ne s’exilent pas non plus (trop contraignant). Ils restent chez eux, anesthésiés, à regarder la télé en pestant. Ils appellent ça l’exil de l’intérieur : retrouvez toute l’impuissance et le déracinement de l’exil, sans bouger de chez vous !
J’avais entendu ça dans un reportage à la radio allemande, il y a trois ou quatre ans. J’étais en train de courir autour du lac Daumesnil, à la nuit tombée, et j’avais trouvé ça prodigieusement russe de théoriser ainsi l’apathie et l’impuissance petite bourgeoise jusqu’à en faire un mouvement avec un nom, peut-être même un logo ou un manifeste.
Dans les reportages de Deutschland Radio sur la Russie, la question de « l’âme russe » (ou assimilé) revient toujours. Je me souviens m’être trouvé face à un gouffre culturel en écoutant un reportage sur les J.O. de Sotchi, je crois, avec une jeune Russe extatique expliquant à quel point le set du DJ qu’on entendait en fond sonore était essentiellement, fondamentalement russe. Elle s’en foutait des questions de la journaliste sur la corruption et le gaspillage d’argent public. Elle voulait nous expliquer la russitude de la transition qu’on venait d’entendre.
Ce genre de sortie laisse toujours les journalistes allemands tout à fait sceptiques, un peu comme quand ils tentent d’expliquer à leurs auditeurs nos arguties invraisemblables sur la laïcité, le mariage homosexuel ou la bouffe.
(Toujours à propos de la Russie : je lisais l’autre jour, je ne sais plus où, que l’outil de propagande le plus efficace de Poutine, ce n’est pas Russia Today, dont les mensonges sont grossiers au point d’être risibles, mais plutôt une chaîne de télé qui diffuse des faits divers 24 heures sur 24, avec force détails sordides. Comme ça tout le monde reste bien persuadé qu’une main de fer est nécessaire.)
En septembre dernier, en me préparant à prendre l’avion, j’ai constaté, stupéfait, que ma carte d’identité était périmée. Dix ans ont donc passé depuis la fois où je suis rentré en France seulement muni d’un laissez-passer obtenu auprès d’une fonctionnaire extrêmement patiente de l’ambassade de France à Berlin – à qui j’aimerais pouvoir un jour faire mes excuses de m’être présenté dans son bureau encore alcoolisé et contenant à grand peine mon hilarité. Ah, la jeunesse – bref. Dix ans, donc, que je n’ai pas mis les pieds à Berlin. J’ai horreur de voir le temps si précisément mesuré.
A l’époque j’avais à peu près perdu mon allemand, à force de fainéantise. Pour le reconquérir, j’ai écouté la radio allemande, beaucoup, en courant. Les premières fois ont été atroces. Je suais comme un goret en tentant de comprendre quelque chose à Europa Heute, mais les trois quarts du temps j’étais complètement perdu. Je me sentais amputé d’une partie de moi-même – et pas n’importe quelle partie : mon adolescence. Consciemment ou non, c’est elle que je voulais retrouver en réapprenant la langue de Nietzsche, Kleist et Thomas Bernhard.
Alors j’ai couru, couru, couru. Au début je me préparais en lisant la description des podcasts, pour ne pas passer la moitié du reportage à comprendre ce dont il était question. Et puis un jour je me suis aperçu que ça n’était pas nécessaire. Je ne sais pas combien de fois j’ai fait le tour du Lac Daumesnil, finalement – suffisamment, en tout cas, pour apprendre beaucoup de choses sur la Russie. Le jour où j’ai réalisé en racontant un truc que je ne savais plus si je l’avais entendu en allemand ou en anglais, j’aurais pleuré de joie.
En décembre dernier j’ai traduit le catalogue d’une agence de voyage suisse. Il y avait notamment une croisière voilier + vélo en mer du Nord, autour de Rügen, et j’ai senti mon coeur se serrer. J’aurais voulu partir tout de suite. Voir Victoria n’a rien arrangé : c’était comme de savoir enfin ce qu’étaient devenu mon correspondant de seconde et ses potes.
Alors je sais bien qu’il n’y a pas de retour en arrière, pas d’âge d’or à regretter ni à retrouver, où que j’aille. Ca ne m’interdit pas de rêver à quitter l’exil de l’intérieur pour faire la dernière partie du chemin : retourner à Berlin et enfin retrouver ma langue, et puis parler à n’en plus finir, debout dans la rue une bière à la main, sous trois ou quatre couches de vêtements – l’alcool et les amis et le froid suppléant inexplicablement aux imprécisions de ma grammaire de mon vocabulaire, le temps que ça revienne complètement.
Photo : Kaffee Burger, par Lucía Ponce (photo en tout point conforme à mon souvenir)
Ma porte

Ma porte est en mauvais état. Il faut dire qu’elle est vieille et pas très bien entretenue – c’est ma faute, au début j’ai peiné à prendre la mesure de mes responsabilités de propriétaire de maison ancienne. On l’avait repeinte en rouge vif en arrivant pour faire les malins mais on a trop attendu pour s’attaquer au fond du problème.
Le problème ce sont les fuites. J’ai beau combler les trous à la résine, poncer, repeindre, refaire les joints, changer la serrure, que sais-je, la réalité finit toujours par se glisser sous le seuil. C’est assez déplaisant, la réalité : ça s’insinue partout et ça colle, sans parler de l’odeur.
Ces derniers temps, le climat est particulièrement hostile. Des vagues de réalité submergent les digues que nous avions si patiemment établies, et les embruns finissent sur ma pauvre porte à demi vermoulue. On doit faire attention avant d’ouvrir, jeter d’abord un oeil par la fenêtre pour vérifier qu’on n’est pas en crue – si on y prend pas garde, on se retrouve avec de la réalité plein le couloir. Après il faut des heures pour tout nettoyer.
Je l’aime, cette porte. Je n’ai pas envie de la changer. On a toujours été super bien cachés derrière, et je n’ai aucune envie de la remplacer par une merde en PVC qui serait certainement plus étanche, mais combien plus laide – et Dieu sait qu’il y a assez de laideur comme ça autour de nous.
Il faudrait nous rendre à l’évidence : le niveau monte. Ou alors c’est nous qui nous enfonçons, je ne sais pas, mais en tout cas le moment approche où nous devrons choisir entre rester enfermés chez nous en permanence et laisser la réalité inonder notre intérieur. Elle viendra pourrir les pieds de nos meubles et le goût de notre vin, détremper les chaussettes de nos enfants, moisir nos livres et salir le carrelage que nous avions si patiemment choisi.
Photo : Porte rouge, par Pixoeil