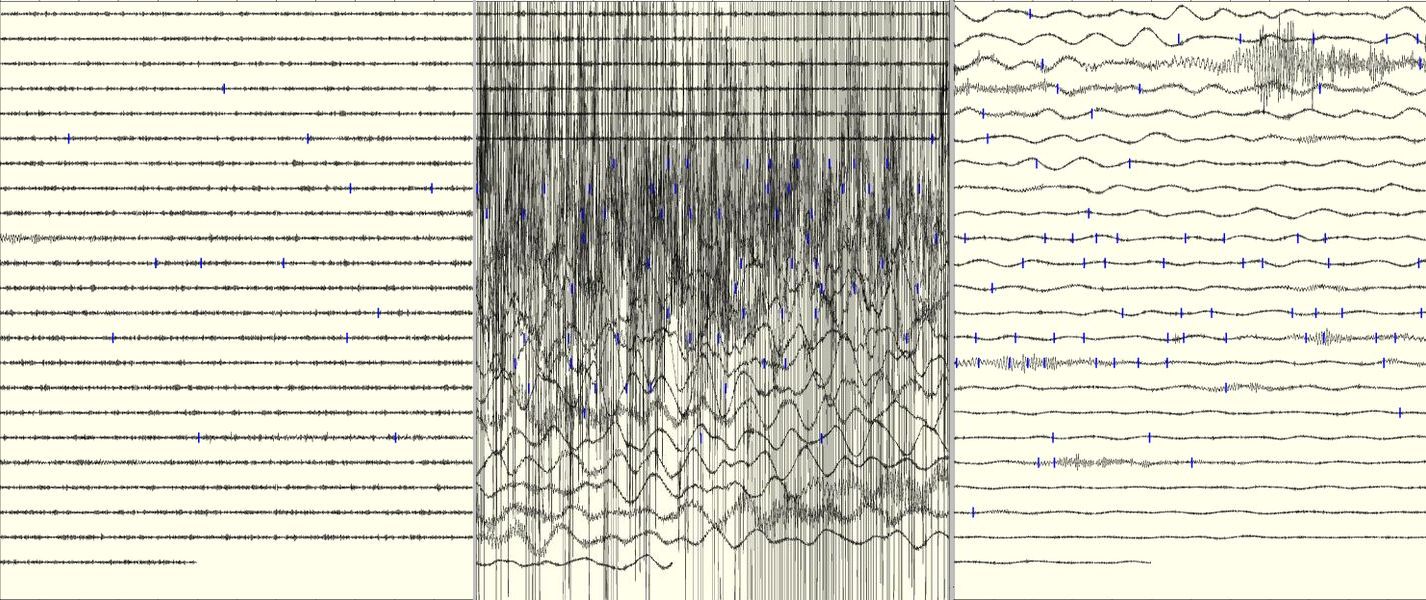Le Japon c’est toujours l’autre. L’étrange, l’exotique, celui d’en face. Dans l’Empire des Signes, Roland Barthes disait seulement : « là-bas », en italique et tout, pour qu’on sente bien tout l’oblique de la situation. Il avait découvert le Japon comme un collégien rencontrerait son professeur au supermarché, réalisant soudain que ce dernier n’habite pas dans un placard de la salle de classe. Regarde, chérie, regarde leurs maisons en papier, leurs marionnettes, leurs sceaux – regarde, c’est prodigieux, regarde comme ces petits hommes sont ingénieux !
Mais sitôt revenu de son émerveillement, Barthes se désole de trouver le Japon authentique, sauvage, etc. — son Japon — proprement gangrené par une modernité odieusement familière, toute en plastique et en métal. « Le Japon entre dans sa mue occidentale », écrit-il, « il perd ses signes, comme on perd ses cheveux, ses dents, sa peau ; il passe de la signification (vide) à la communication (de masse) ». En réalité, au moment où Barthes écrit l’Empire des signes, la ‘mue’ du Japon est achevée depuis un demi siècle, au bas mot.
Le pays s’est ouvert au monde et à l’Occident en 1854, après plus deux siècles d’isolement. Dans les décennies qui suivent, les Japonais font la guerre, asservissent des peuples, vident leurs campagnes, construisent des villes immenses, des chemins de fer et des usines, ils ouvrent des cinémas, créent des banques et des partis politiques corrompus et des journaux par milliers. En un mot, ils deviennent modernes.
Au début du XXe siècle, après 50 ans de cette modernisation à marche forcée, les Japonais sont épuisés. Ils rêvent au Japon disparu, celui d’avant Meiji, ils rêvent à leur âge d’or pré-moderne, aux moeurs pittoresques mais finalement rassurantes du Japon des Tokugawa. Ils sont captivés par le récit des enquêtes du vieil Hanshichi, le rusé policier de quartier du vieil Edo. Hanshichi est un vieillard qui raconte au narrateur ses exploits d’antan, lorsqu’il traquait voleurs et criminels dans les rues d’Edo, la ville qui n’était pas encore la capitale du Japon. Sorte d’anti-Sherlock Holmes, Hanshichi démasque le coupable grâce à des méthodes résolument non-scientifiques. La clé de l’énigme est toujours quelque coutume bizarre de l’ancien temps, emportée par la restauration de Meiji, que les lecteurs sont ravis de redécouvrir. Les enquêtes d’Hanshichi connaissent un succès énorme, fondant un genre qui s’est perpétué jusqu’à nos jours, parce qu’elles sont un prétexte à se vautrer dans une aimable nostalgie. En 1917, le Japon n’existait déjà plus.
En 1923, un tremblement de terre gigantesque ravage Tokyo et le Kanto. Les bas-fonds d’Asakusa si chers à Tanizaki, derniers reliquats du vieil Edo, disparaissent sous les décombres. Ils sont bientôt remplacés par des bâtiments flambants neufs, rigoureusement cubiques. C’est aussi en 1923 qu’Edogawa Rampo, le feuilletoniste le plus débridé du Japon d’avant-guerre, publie sa première nouvelle. Dans les dix années qui suivront, il n’aura de cesse de chanter ce Tokyo disparu, celui de Meiji, ses maisons pourries et son Panorama – la modernité artisanale, naïve et spontanée, profondément japonaise que le tremblement de terre de 1923 a emportée. Longtemps avant que Barthes ne s’en désole, le Japon était mort et enterré.
Dans les années 60, tandis que Roland Barthes pleure auprès du corps alité d’une poupée de bunraku qu’il prend pour un cadavre, le jeune Naoki Urasawa rêve de robots géants, de conquête spatiale et d’avenir pour son pays, un pays vaincu, pauvre et sale, et qui lui paraît bien arriéré. Quarante ans plus tard, Urasawa écrira XXth Century Boys, un feuilleton mélancolique et interminable sur le temps qui passe et le rock’n’roll, où des héros décrépits se révoltent contre une modernité qui les a bernés. Enfants, ils rêvaient de cosmonautes et d’androïdes, et l’an 2000 n’a amené que des catastrophes. Les années 60 leur ont menti : ils sont devenus vieux. Le Japon qu’ils attendaient n’est jamais venu.
Le Japon n’est jamais là, jamais au bon moment. Moi-même, je ne peux m’empêcher de rêver au Japon de ma jeunesse, celui qu’on montrait partout à la télé, celui qui fabriquait nos consoles et fournissait les méchants de nos films, le Japon triomphant et ultra-technologique des années 80. Une société « extrême », disaient les journaux, je me souviens bien : la prospérité et ses marges, la conformité et l’exclusion, des otaku et des sararimen et des yakuza que Kitano n’avait pas encore donné à voir, des machines fantastiques et inexplicables, terriblement numériques. C’est ce Japon que William Gibson a caricaturé dans le Chiba de Neuromancer, ce sont ses entreprises toute-puissantes terrifiaient les Américains, ce qui ne les empêchait pas de s’arracher les walkmans qui sortaient de leurs usines.
Aujourd’hui les ordinateurs se ressemblent tous, Sony, Sharp et Mitsubishi licencient à la pelle, Sega ferme ses bureaux internationaux les uns après les autres. Alors je rêve à un Japon qui n’existe plus – moi aussi, lui non plus. Je peux presque le toucher, mais au dernier moment la porte se referme. Le Japon n’est pas là, il ne nous laisse pas rentrer. Il nous glisse bien quelques dessins sous la porte, dans l’espoir que l’on cessera enfin de l’importuner, mais ils n’arrivent jamais intacts de l’autre côté. Le voyage transforme tout.
Dans les années 80, les dessins animés diffusés par La 5 de Berlusconi faisaient escale par l’Italie avant d’être diffusés en France ; ils nous arrivaient mutilés par deux couches de censure et de traduction (traduction au cube). Et malgré tout, même comme ça, quelque chose du Japon nous atteignait. Planté devant la télé six heures par jour, je parcourais, fasciné, un Tokyo incroyablement exotique, aux rues bétonnées, propres et sans style, sans rien de commun avec ma province empesée d’histoire et de crasse. Je me souviens des fils électriques grésillants et de feux de circulation inexplicablement bleus et horizontaux, de voitures inconnues qui roulaient à gauche. Parfois, surtout l’hiver, mon esprit vagabonde et je rêve à un train de banlieue à deux wagons, fendant la campagne japonaise sous le soleil d’avril.
Aujourd’hui encore, pour un film japonais qui trouvera un distributeur à l’étranger, cinquante ne seront visibles qu’avec des sous-titres amateur, rédigés dans l’urgence par des internautes enthousiastes mais pas toujours compétents. A l’époque du 8-bit, les jeux vidéo étaient traduits n’importe comment (All your base are belong to us), aujourd’hui ils sont écrasés par la concurrence américaine avant même de sortir de l’archipel. Ceux qui sont traduits le sont à la va-vite et au rabais, avec des coupes et des choix d’adaptation arbitraires qui ne sont pas sans évoquer les doublages les plus créatifs de Ranma 1/2. A l’arrivée, il nous reste un empilement de styles sans passé, ordonné selon un système qui manifestement nous échappe. Des références tous azimuts, aux Grecs et au Christ et à Gaïa et au Valhalla. Immédiate, synchrone, nivelée, la production d’un pays qui a reçu toute notre histoire d’un seul coup et ignore superbement nos hiérarchies.
Il n’y a donc rien de très étonnant à ce que le Japon nous inquiète un peu, parfois. On parle à mi-voix de sa pornographie insupportable, de son incapacité à respecter des tabous que nos ethnologues ont pourtant déclarés universels. On s’amuse de ses love hôtels, des distributeurs de petites culottes, des livres de maths pour otaku, de ses tueurs sanguinaires et de son goût pour l’outrance et le gore. On raconte des histoires fantastiques : les pommes s’y vendent au prix de l’or ! Les punks y sont d’une politesse effarante ! Les gens y dorment dans des sortes de ruches ! Les rues n’y ont pas de nom, mais les carrefours, si ! Le Japon, c’est l’autre, je vous dis.
Soyons juste : en ouverture de l’Empire des Signes, Barthes fait tout de même figurer un avertissement. Il dit : je ne parlerai pas du Japon, non, mais d’un lieu imaginaire, éthéré et inaccessible, peuplé de geishas et d’hommes pressés. Là-bas. Il ne remarque pas que c’est précisément parce qu’il parle d’un lieu qui n’existe pas (le vide, les ombres, l’île, que sais-je) qu’il parle du Japon. Le Japon c’est toujours ailleurs, en face, au bout. Un monde renversé et grotesque, l’image déformée, affreuse, offerte par un miroir de cirque. L’horreur indicible de la symétrie, identique et pourtant renversée : le monstre du miroir.