La sérigraphie
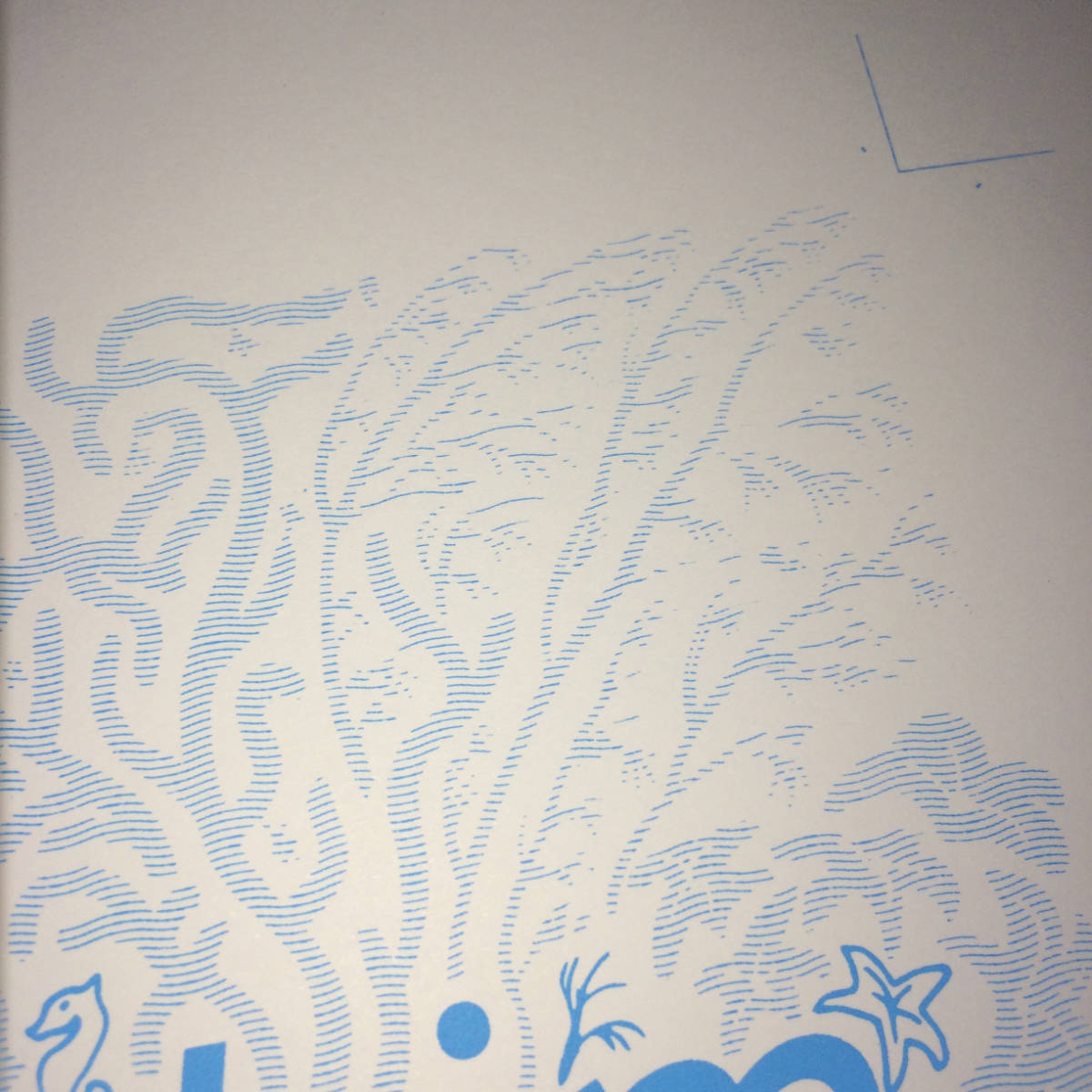
Le seul livre à avoir littéralement changé ma vie c’est l’Eloge du carburateur. Matthew Crawford y raconte comment il est parvenu à s’extraire d’une carrière intellectuelle, aliénante et absurde (rédiger des fiches de lecture à une cadence infernale pour un système de gestion documentaire primitif, puis diriger un think tank) pour devenir mécanicien moto. Pour notre génération de développeurs web qui se reconvertissent en masse dans la brasserie artisanale ou la confection de bijoux, le sujet paraîtra peut-être galvaudé : on voit déjà venir une célébration populiste et finalement condescendante de l’intelligence de la main contre celle de la tête.
Pourtant il ne s’agit pas de lamenter la fin du bon vieux temps, mais simplement de dire que le sentiment du travail bien fait et la conviction de sa propre d’utilité sociale font de la mécanique une activité autrement plus gratifiante que la grande majorité des métiers qu’on peut espérer exercer en sortant de l’université. Et par-delà les promesses de gratification, de paix intérieure et de retour au concret, l’idée qui a fini par emporter mon adhésion fut la suivante : un métier manuel mobilise bien plus l’intelligence que n’importe quel travail de bureau. Les facultés analytiques, la rigueur, l’ingéniosité et l’esprit de synthèse sont mis à l’épreuve bien plus durement par le diagnostic d’une panne mécanique que par la rédaction d’un quelconque rapport, et c’est bien cela l’intelligence, celle qui danse et jubile.
Incidemment, Eloge du carburateur est un des derniers livres que m’ait offert mon père. Sur le moment je n’ai pas du tout compris pourquoi il m’avait acheté ça, j’ai pensé que c’était une recommandation de Télérama ou d’Alternatives Economiques. C’était peut-être une manière de me dire que que je pouvais arrêter de m’acharner à chercher une profession intellectuelle et respectable, alors que ça me rendait manifestement malheureux.
Je me souviens distinctement m’être interrompu à un moment de ma lecture pour prendre pleinement conscience que le meilleur moment des deux années que je venais de consacrer à apprendre la programmation informatique avait sans doute été l’après midi passée à fabriquer un cerf-volant pour mon ventilateur. J’ai mis ça sur le compte de la fatigue.
La technique de la sérigraphie est complexe, chaque étape peut merder de plusieurs façons différentes, souvent irrémédiablement, et parfois de façon imperceptible avant d’en arriver au tirage.

Par exemple, le petit trait blanc que vous pouvez apercevoir au milieu de la jambe du « m », à droite de l’image, c’est une micro-rayure sur le typon qui a fait cuire une fine ligne d’émulsion au milieu d’une zone qui aurait dû rester poreuse. Ca crée un trait imperceptible au beau milieu du cadre, qui se traduit au tirage par un manque là où il devrait y avoir de l’encre.
Si j’avais pris deux minutes de plus pour inspecter mon typon sur une table lumineuse avant d’insoler, tout aurait été réglé d’un petit coup de feutre noir. Là j’étais quitte pour recommencer à zéro une bonne demi-journée de boulot.
Je pourrais m’en tenir là et vous dire que la sérigraphie m’a appris la minutie, mais ce ne serait pas tout à fait vrai. La vérité c’est que malgré mes meilleurs efforts, il y a toujours un truc qui foire, une nouvelle merde avec laquelle composer pour cette fois et à éviter la prochaine.
Or voilà la vraie leçon : ça va foirer immanquablement, et à ce moment-là il faudra serrer les dents, continuer en tirant sur le manche au maximum, aller au bout quand même et juger à la fin du résultat, au lieu de tout envoyer valser en gueulant « Putain si c’est ça je me casse » sitôt que la réalisation s’écarte ne serait-ce qu’un tant soit peu de mes rêves de perfection géométrique.
J’apprends à vivre avec les échecs et les résultats imparfaits, à leur trouver une utilité et même, parfois, à m’en satisfaire.
Récemment, un ami m’a dit qu’il m’avait vu passer les quinze dernières années à me hisser sans cesse jusqu’aux portes de la réussite, avant de renoncer chaque fois au moment de les franchir. Quelques fois ça a été par fierté ou par coquetterie, mais le plus souvent c’était parce que j’avais peur. Ma pente naturelle c’est de partir tête baissée, sans préparation et sans filet, parce que la prudence et les précautions sont les armes des faibles. Au moindre soupçon que quelque chose va foirer, je quitte le navire précipitamment et je recommence autre chose.
Plus récemment encore, on m’a demandé si je n’avais pas peur de me planter avec mes histoires de faire-parts. Pas du tout. Si je me plante, c’est que j’ai essayé, pour une fois.
La sérigraphie m’a donné une manière de vivre avec mes ambitions contradictoires, mon insatisfaction, mon impatience. Je veux bien faire mais je vais toujours trop vite, et j’apprends à faire avec. J’emmerde les artistes et je ne sais pas dessiner mais j’aime le papier et les lignes et les couleurs, et au nom de quoi devrais-je me priver ? Quand j’écris, je pense le texte mis en page et illustré, et je veux pouvoir lui donner corps, là maintenant, avec mes outils – et tant pis si ça fait moins chic dans les dîners que quand je mourrais d’ennui au CNRS.
C’est dur de faire tourner l’atelier seul, il y a toujours un truc qui merde quelque part, mais je progresse. Je ne suis jamais si fier que quand je répare ma photocopieuse ou quand je construis une insoleuse, même rudimentaire. Quelles que soient les satisfactions que m’offrent la traduction ou le code, elles ne font pas le poids. Disons : il peut m’arriver de sourire quand je trouve une traduction élégante ou de soupirer d’aise quand je résous un bug, mais il n’y a que quand je sors un beau tirage que je jubile.
Quand on repartira vivre dans une grande ville, cette fois je me sentirai prêt à aller bosser dans un atelier collectif, pour profiter un peu de la compagnie des autres et mutualiser une partie du travail.
Normalement c’est l’inverse, je sais bien, on commence dans un atelier collectif et ensuite on a le sien, mais moi non, je veux toujours tout, tout de suite. Tant pis si c’est dur. Normalement on commence par des boulots subalternes, on y fait ses preuves (la preuve de sa soumission et de la malléabilité, essentiellement), et ensuite on devient indépendant. Normalement on se choisit un maître et un jour on le renie. Normalement on a des parents qui nous enferment et à qui on échappe un jour. Moi non. J’apprends toujours seul et dans la douleur, et la dernière leçon que la sérigraphie m’ait apprise, c’est qu’on ne se refait jamais complètement, quels que soient nos efforts.
