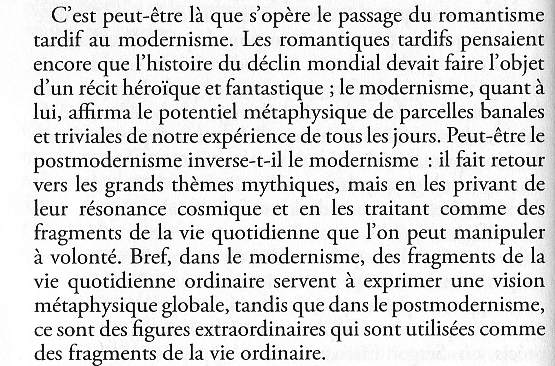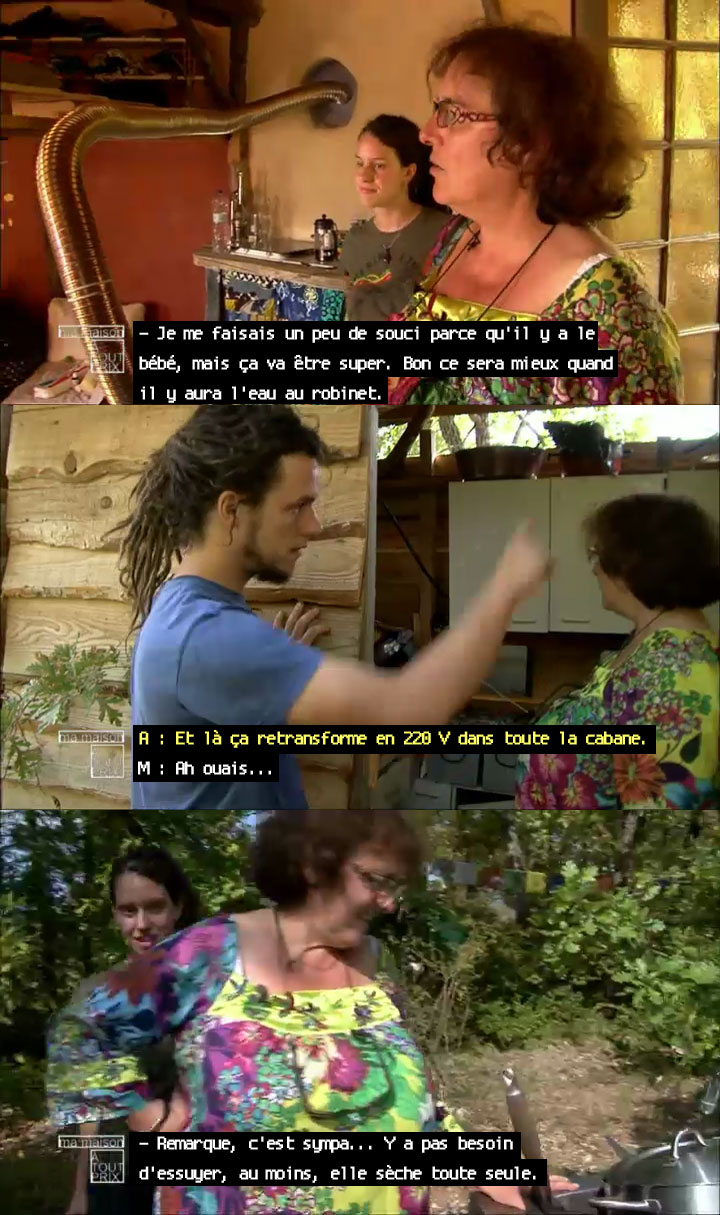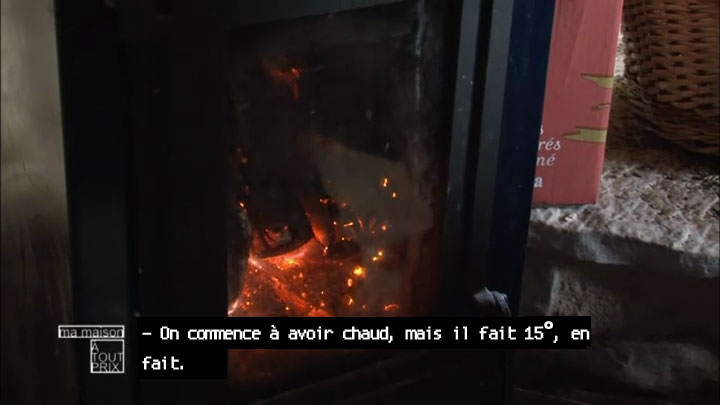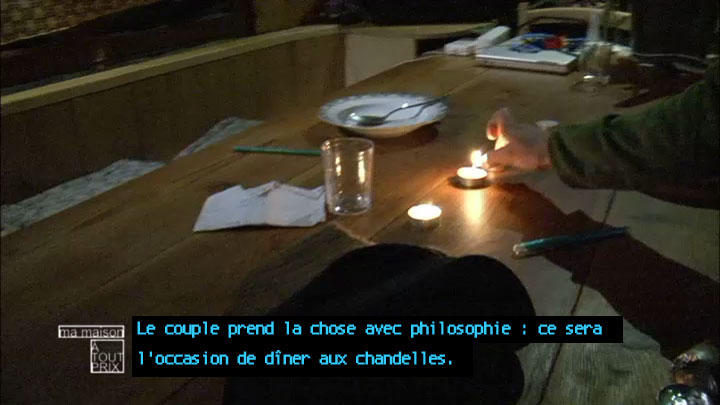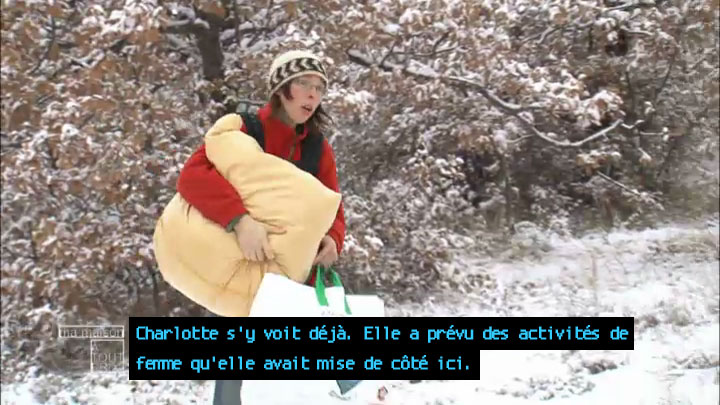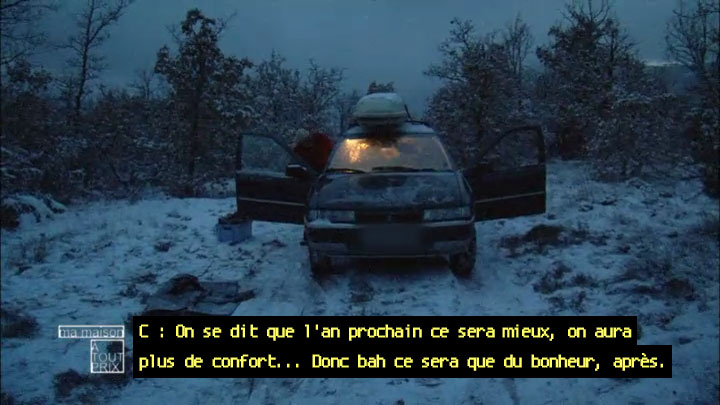Dans Into the Wild, un jeune homme brillant cherchait le sens du monde dans un vieux bus perdu en Alaska. Dans Up in the air, George Clooney refusait de s’encombrer de possessions ou de relations qui auraient immanquablement ralenti une vie entièrement vouée au mouvement. Chaque jour, un peu partout en Occident, de jeunes idéalistes partent à l'assaut du bush australien dans de vieux combis VW tout droit sortis d'une reconstruction dorée des années 70. Tous ces héros veulent triompher de l’enfermement, fuir l’aliénation de l’immobilité et échapper à l’emprise du monde. Ils veulent être libres. Ils échouent.
Pendant ce temps, sous leur nez, un type parfaitement ordinaire parvenait à se soustraire au monde, prouvant que la modernité recélait encore la possibilité de l’aventure — et pour y parvenir, il lui a suffi de sortir de chez lui. Huit mois durant, ce type a vécu comme un aventurier à bord de son pick-up truck, puis il est revenu d'entre les vivants pour nous raconter, à nous les assis, les voyeurs, les zombies, les morts.
Prologue
Ca commence sur reddit, il y a plus d’un an. Un jeune Américain raconte qu’il va se retrouver à la rue. Il a peur. Il veut savoir comment faire. Il panique. Il n’a jamais vraiment mis les pieds dans la réalité, et voilà qu’il va devoir s’y confronter sans aucun des petits conforts qui nous la rendent supportable, habituellement. Il se tourne vers celui qui a toujours été son meilleur secours, le web. Et voici ce que le web lui répond :
Les conseils sont clairs et pratiques, l’analyse lucide et éclairante : garder la tête froide, prévoir et, quoi qu’il arrive, faire le nécessaire avoir plutôt l’air d’un aventurier que d’un déclassé. Dans la discussion qui s’engage à la suite de ce premier message, nombreux sont ceux qui expriment leur admiration voire, paradoxalement, leurs félicitations. Dans leur clarté et leur simplicité, ces quelques conseils suscitent une fascination immédiate : le public exige que l’homme au pick-up raconte son histoire. Il s’exécute.
Le voyage
A l’origine, il y a une tentative manquée pour ‘flip a house’*, mêlée à une rupture difficile. Au fond peu importe. Après l’échec de sa transaction, notre héros se trouve seul, sans un sou, et à la tête d’une dette de 20 000$. La solution normale, raisonnable, acceptable consisterait à prendre un second travail et/ou à se tuer à la tâche, des années durant, pour sortir de l’endettement. Au lieu de cela, notre héros décide de se débarrasser de toutes ses possessions, qu’il donne, mis à part un GPS, un ordinateur et le matériel de camping qu’il entasse dans son pick-up. Il annonce à son employeur qu’il veut travailler à distance. Par chance, le patron accepte. C’est tout. La dernière barrière vient de se lever. Il vivra pour le moins cher possible, jusqu’à avoir réuni de quoi rembourser sa dette. C’est le début de 8 mois de vie brute, nette, cassante, non filtrée.Chemin faisant, il rencontre des personnages. Des amis, des ennemis. Il subit des épreuves. Il est chassé des beaux quartiers. Il est attaqué dans le ghetto. Il doit chercher asile sur les parkings des supermarchés et des églises. S’il a de la chance, il peut profiter de l’hospitalité – ou, mieux encore, de la douche – de ses nouveaux amis ou de ses quelques conquêtes.
* Acheter une maison à bas prix, y faire des travaux et la revendre rapidement pour empocher la plus-value. C’était la grande mode aux Etats-Unis, au moment de la crise des subprimes.
A la fin, le hasard (son destin) le ramène à une réalité autrement plus terre à terre, moins onirique : un membre de sa famille a le cancer, et il est le seul à disposer de suffisamment de temps pour aller l’accompagner vers ses derniers jours. On voit soudain apparaître des thèmes plus spirituels : le respect des anciens, la piété filiale. L’homme au pick-up, pour être un héros, n’en a pas moins le sens du devoir. Il interrompt son aventure et se rend au chevet du malade.
C’est là que se situe l’extraordinaire. Libéré, plusieurs mois durant, des contingences, il n’a pas perdu pied. Il est toujours en contact avec la société, même s’il a vécu dans ses marges.
Ironie du sort : tandis qu’il s’occupe de son oncle, son pick-up est détruit dans un accident. Il est privé de tout moyen de poursuivre son aventure. Que fait-il ? Il raconte. Il prodigue ses conseils à un malheureux qui s’apprête à vivre la même expérience, mais sans l’avoir choisie. Et surtout, il économise pour se racheter un camion.
A l’horizon
Le retour à la vie nomade est une perspective — c’est la vie des pionniers et des premiers hommes, un mélange exquis de deux des choses que nous cherchons inlassablement, la mobilité et l’authenticité. On la voit flotter à l’horizon et elle nous aide à vivre.
En ce sens, elle n’est guère différente des hôtels de Trinidad & Tobago, ou des offres d’emploi des ONG installées en Afrique, ou des expéditions absurdes pour atteindre le pôle Sud ou pour traverser l’Amazonie en ballon. Nous supportons l’horreur du monde parce que nous espérons qu’un jour, nous parviendrons à attraper les carottes que nous voyons pendre à l’horizon. Je peux continuer à vivre comme un imbécile, me dis-je, ployant sous le poids de mes possessions, car quelqu’un, quelque part, préserve la dignité du genre humain à ma place, et un jour ce sera mon tour (de traverser le désert, de remonter l’Amazone, d’aller faire de l’humanitaire, de gravir l’Everest).
Dans l’intervalle, la modernité n’a pas que des désagréments. Notre confort vaut bien une alliance tactique avec l’ennemi, n’est-ce pas ? Nous voudrions revenir à la nature, évidemment, mais en gardant l’accès au net. Nous voulons bien vivre une vie labellisée développement durable, mais un sèche linge c’est quand même plus pratique. Et caetera.
Et puis nous n’avons pas tellement le choix, apparemment. Il n’y a pas de boulot payé décemment pour des heures décentes. Il y a l’exploitation au SMIC horaire, sordide et terrifiante ; et il y a l’exploitation qualifiée, d’autant plus aliénante qu’on est conscient d’avoir bien de la chance de ne pas être plus exploité encore. Il y a l’éternel retour du salariat et l’auto-exploitation des professions libérales. Il n’y a pas d’option.
Comment diable supportons-nous cela ? C’est simple, l’alternative c’est la rue. Voilà pourquoi l’homme au pick-up nous fascine. Il a choisi consciemment une situation que le reste de la société fuit à toutes jambes, fût-ce au prix de sa santé mentale. Il n’a eu à faire aucun des sacrifices normalement requis : il a conservé son travail, sa dignité, sa capacité à communiquer avec les autres – sa place dans la société. Il l’a fait, puis il en est revenu. Il est remonté des enfers, et il ne s’est pas retourné au dernier moment.
L’homme au pick-up est fascinant parce que son expérience représente une forme de martingale. Il est parvenu à se mettre dans une position théoriquement impossible : à la marge mais jamais vraiment exclu, un parasite, un escroc qui a falsifié sa signature sur le contrat social.
A l’image du hobo avec son baluchon, l’homme au pick-up ne s’encombre de rien qui ne soit strictement essentiel. Opérant un tri radical, il réduit ses possessions au strict nécessaire. Il garde ce que la modernité lui a donné (mobilité, culture, net omniprésent) et reprend tout le reste : son temps, sa liberté de mouvement, son esclavage. Il bourre ses poches d’échantillons gratuits sans se sentir la moindre obligation d’acheter quoi que ce soit.
Ce que la société attend de lui en retour, c’est-à-dire sa soumission à l’ordre établi — ou au moins un premier pas sur le droit chemin, pour montrer sa bonne volonté — il ne fera rien de tout ça. Il sera libre, tout en refusant de payer le prix que paient généralement à ceux qui choisissent de l’être (la saleté, et son pendant théorique, le déclassement). Il atteint une sorte d’idéal ascétique, sans rien de la rigueur que l’ascèse nous évoque normalement. Certes, il y a bien de la discipline, mais c’est très sain, non ? En tout cas c’est plus sain que notre laisser-aller, oui, bien entendu. Bien entendu. Nous le regardons avec une fascination morbide, parce que le prix à payer pour occuper cette position inhabituelle et impossible paraît soudain dérisoire. Et après tout, pourquoi ne pas nous priver d’eau courante, si cela nous rend libres ?
Pour atteindre cette position, l’instrument le plus puissant dont il use est l’impression qu’il dégage, c’est-à-dire, à la racine, sa vision de lui-même. C’est pour cela que ses conseils appuient tant sur la nécessité d’avoir l’air, de donner l’impression, de sembler. Il devrait y avoir quelque chose de sordide à voir un ancien SDF raconter comment il se débrouille pour que ses vêtements ne sentent pas mauvais, et pourtant non : nous écoutons, épatés par tant d’audace et d’astuce – précisément parce que celui qui nous parle est un aventurier, et non un déclassé.
L’homme au pick-up est fascinant parce qu’il est un passager clandestin, non dans un train, mais dans le monde. Il n’a même pas besoin de se terrer dans les wagons à bétail : il s’installe au beau milieu de nous, invisible parce qu’impossible à distinguer du reste des hommes. C’est que sa cachette n’est pas physique, mais conceptuelle — il se cache dans l’angle mort du panoptique.
Interlude — La cabane
Le mythe
Pendant un moment, Roger Nuisance et moi avons sérieusement envisagé de transposer l’histoire de l’homme au pick-up en France pour en faire un récit picaresque mâtiné de réalisme social.
Ça se serait appelé « Simca 2000 », et ça aurait raconté les aventures de Michel Chevalier, anarchiste, renégat, rebelle, sillonnant la France dans une vieille Simca, poursuivi par un passé trouble.
Nous avions imaginé que l’homme au pick-up, vivant sans domicile et sans attache mais au beau milieu de la société, découvrait bientôt qu’il n’était pas le seul passager clandestin. Au fil de ses voyages, on aurait exploré progressivement tout un monde (symboliquement) souterrain, des squats et des tentes et des sous-sols et des maisons de vacances peuplées d’ultra-nerds, de contrebandiers, de néo-zapatistes, d’immigrés clandestins, de jeunes écolos, de zombies ou d’escrocs en fuite. Plus encore que l’underground, Simca 2000 voulait raconter ce qui se trame dans les failles de la société, dans ces interstices symboliques où se glissent désormais les marginaux.
Simca 2000 aurait été le feuilleton des oubliés, des invisibles, des faussaires, des cypherpunks et des clodos, des nomades et des aventuriers urbains — des hommes libres.
Et aujourd’hui, me dira-t-on, que devient l’homme au pick-up ? Un an après avoir posté le message qui m’a tant bouleversé, il continue à prodiguer ses conseils aux malheureux qui échouent sur reddit et craignent de se retrouver à la rue (il s’est un peu diversifié, aussi).
Je lis ce nouveau thread reddit, si semblable à celui dont tout est parti, et soudain, je comprends mal ce qui m’avait tant fasciné l’an dernier. L’innocence et la spontanéité, l’urgence de la discussion originelle ont disparu. Je me sens face à une situation hypothétique, calibrée, plutôt de l’ordre de l’énigme à résoudre que de l’appel au secours. Après leur vacances bien méritées, le cynisme et le découragement reprennent le dessus.